Introduction : une phrase qui pique encore aujourd’hui
On l’entend dans les couloirs des écoles, sur les réseaux sociaux, parfois même glissée dans une conversation entre amis avec un sourire ironique :
« Ceux qui ne savent pas faire, enseignent… »
Popularisée par l’écrivain George Bernard Shaw au début du XXᵉ siècle, cette phrase semble reléguer l’enseignement au rang des professions “par défaut” : un refuge pour ceux qui n’auraient pas réussi ailleurs. Elle frappe par sa simplicité… et blesse par son injustice.
Pourtant, l’enseignement est l’un des métiers les plus exigeants et les plus complexes qui soient. Il ne s’agit pas seulement de transmettre ce que l’on sait : il faut savoir l’adapter, le rendre compréhensible, captivant, et applicable à des publics très différents. C’est un art, une science, et une responsabilité immense.
Dans cet article – premier d’une trilogie – nous allons replacer cette citation dans son contexte, comprendre pourquoi elle a marqué les esprits, et surtout redonner à l’enseignant la place et le rôle qu’il devrait avoir dans notre société.
1. Origine et contexte de la citation
La formule exacte apparaît dans la pièce Man and Superman (1903) :
« He who can, does. He who cannot, teaches. »
Dans le contexte original, Shaw visait davantage certains intellectuels déconnectés de la réalité que les enseignants en général. Mais sortie de sa pièce, la phrase a pris un tout autre sens. Elle a été reprise, simplifiée, détournée, et est devenue une critique généralisée de l’enseignement.
Résultat : plus d’un siècle après, elle circule toujours, souvent dénuée de nuance, alimentant un préjugé persistant.
2. Pourquoi cette idée perdure-t-elle ?
Plusieurs raisons expliquent pourquoi, malgré les évolutions de l’éducation, cette citation continue à être utilisée.
2.1 Une vision partielle du métier
La plupart des non-enseignants ne voient que la surface visible : quelques heures de cours, des vacances régulières, une “sécurité de l’emploi” supposée.
Ils ignorent :
- Les heures de préparation invisibles.
- Les corrections de copies jusque tard dans la nuit.
- Les formations continues pour rester à jour.
- La charge mentale liée à la gestion de classes et de profils très différents.
2.2 La confusion entre savoir-faire et savoir transmettre
Savoir pratiquer une compétence et savoir l’enseigner sont deux compétences différentes.
Un excellent musicien n’est pas automatiquement un bon professeur de musique. De la même manière, un ingénieur brillant peut être incapable d’expliquer simplement un concept technique à un débutant.
2.3 Une hiérarchie implicite des métiers
Dans l’imaginaire collectif, “produire” est souvent perçu comme plus prestigieux que “transmettre”.
Cette hiérarchie culturelle relègue l’enseignant à un rôle moins valorisé… alors que, paradoxalement, tous les professionnels, quels qu’ils soient, ont appris leur métier grâce à un enseignant.
3. Le rôle réel de l’enseignant
Un enseignant efficace est bien plus qu’un transmetteur d’informations.
Voici quelques dimensions fondamentales de son rôle :
3.1 Transmettre un savoir maîtrisé
L’enseignant doit connaître sa matière sur le bout des doigts, être capable de répondre aux questions inattendues, et expliquer un même concept de plusieurs façons.
3.2 Adapter son discours
Chaque classe est unique. L’enseignant doit savoir changer d’approche selon les élèves, leurs niveaux, leurs centres d’intérêt, leurs difficultés.
3.3 Donner du sens
Un bon enseignant relie la théorie à la réalité. Il montre à quoi sert un concept dans la vie quotidienne ou dans un métier. Il donne aux élèves une raison d’apprendre.
3.4 Inspirer
Au-delà de la matière, l’enseignant transmet un état d’esprit, une curiosité, un goût pour la recherche et l’effort.
4. L’enseignant idéal : vision et valeurs
Si nous devions dresser le portrait de l’enseignant idéal, il aurait :
- La passion de la connaissance : apprendre sans cesse pour mieux enseigner.
- L’empathie : comprendre les blocages et encourager les progrès.
- La rigueur : exiger le meilleur de soi et des autres.
- La créativité : inventer de nouvelles façons de transmettre.
- L’intégrité : rester fidèle à la vérité et à la mission éducative.
L’enseignant idéal est un guide, un mentor, un éclaireur.
5. Enseigner, c’est aussi apprendre
Un aspect souvent ignoré : enseigner oblige à réapprendre ce que l’on croit déjà savoir.
Chaque question d’élève, chaque tentative d’explication différente, chaque adaptation à un nouveau profil renforce la compréhension du sujet.
Un professeur de mathématiques qui explique les équations à un élève en difficulté peut, par ce processus, découvrir de nouvelles analogies, affiner son discours, ou même revoir certains points qu’il pensait acquis.
Enseigner, c’est approfondir sans cesse sa propre maîtrise.
6. Témoignages et anecdotes
- L’artisan : « Former un apprenti m’a obligé à mettre des mots sur des gestes que je faisais instinctivement. C’est en expliquant que j’ai vraiment compris pourquoi je les faisais ainsi. »
- Le scientifique : « Vulgariser mes recherches pour mes étudiants m’a fait voir des liens que je n’avais pas remarqués dans mes propres travaux. »
Ces exemples montrent que l’enseignement est un processus à double sens : on donne, mais on reçoit aussi.
7. Les compétences invisibles de l’enseignant
Être enseignant, c’est aussi endosser, parfois dans la même journée :
- Le rôle de psychologue : gérer les émotions et les tensions.
- Celui de médiateur : apaiser les conflits entre élèves ou avec les familles.
- Celui de gestionnaire : organiser du matériel, planifier les séquences.
- Celui de créateur : concevoir des supports pédagogiques innovants.
Ces rôles multiples sont rarement reconnus à leur juste valeur.
8. Enseigner, un acte de responsabilité
Contrairement à d’autres professions, les conséquences de l’enseignement se prolongent bien au-delà de l’acte lui-même.
Former un futur médecin, un ingénieur, un artisan, c’est influencer la qualité future de leur travail… et donc, indirectement, la vie de nombreuses personnes.
L’enseignant porte une responsabilité éthique : celle de transmettre un savoir juste et utile, et de préparer l’élève à l’utiliser avec discernement.
9. Inverser la citation
Au lieu de dire :
« Ceux qui ne savent pas faire, enseignent. »
On pourrait affirmer :
« Ceux qui veulent continuer à apprendre, enseignent. »
Ou encore :
« Enseigner, c’est savoir faire… et savoir transmettre. »
Ces formules reflètent mieux la réalité d’un métier exigeant et passionnant.
10. Conclusion : vers la suite de la trilogie
Aujourd’hui, j’ai le sentiment que nous avons oublié cette dimension profonde de l’enseignement.
Nous commençons à rendre la citation de Shaw presque véridique, car on réduit souvent le métier d’enseignant à un simple salaire de fin de mois – comme tant d’autres professions.
Mais ce n’est pas le sujet de cet article.
Nous développerons cette idée dans le troisième volet de cette trilogie, après avoir exploré, dans le prochain article, la richesse invisible du métier d’enseignant : être à la fois élève, psychologue, chercheur, inventeur, créateur….
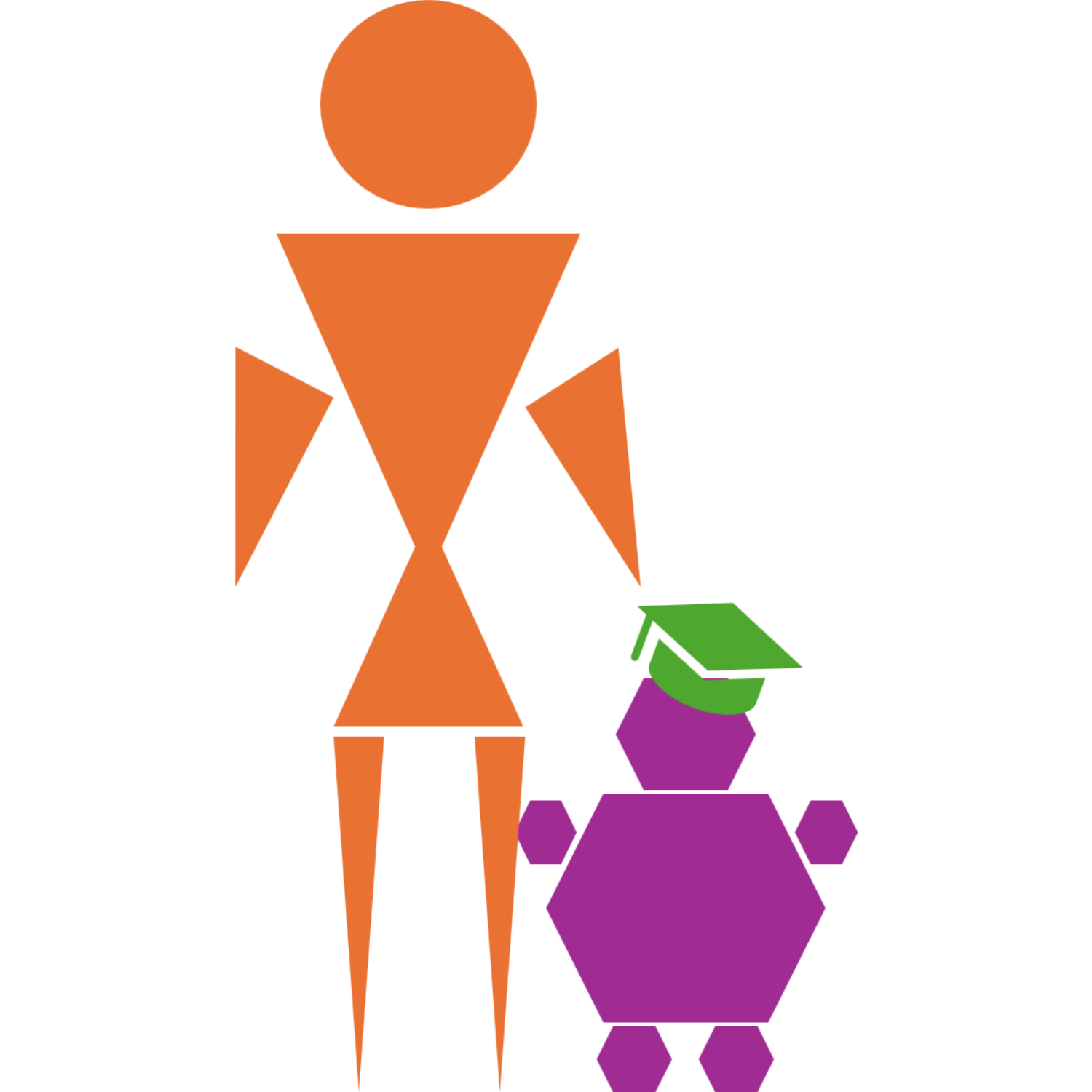


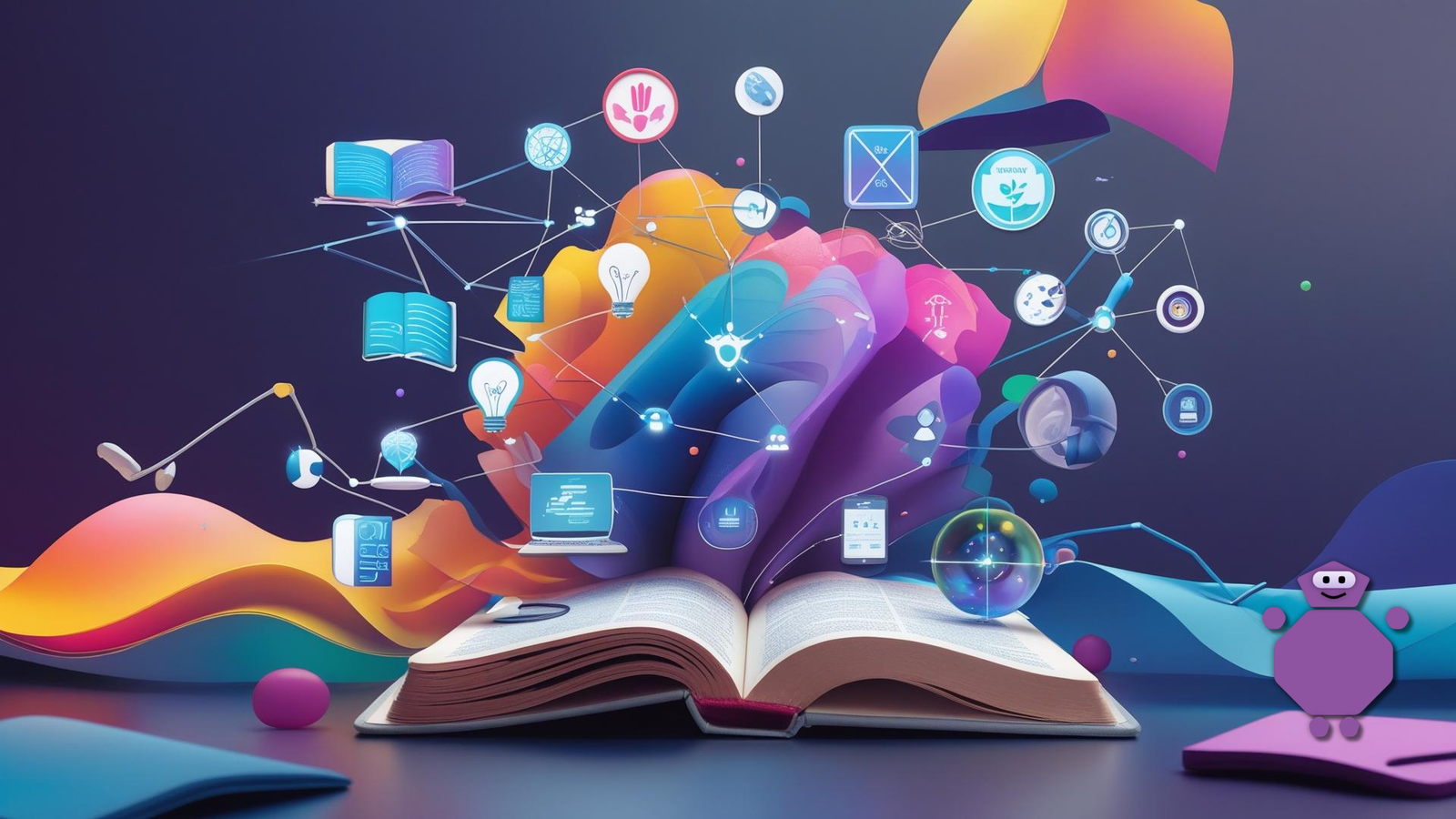
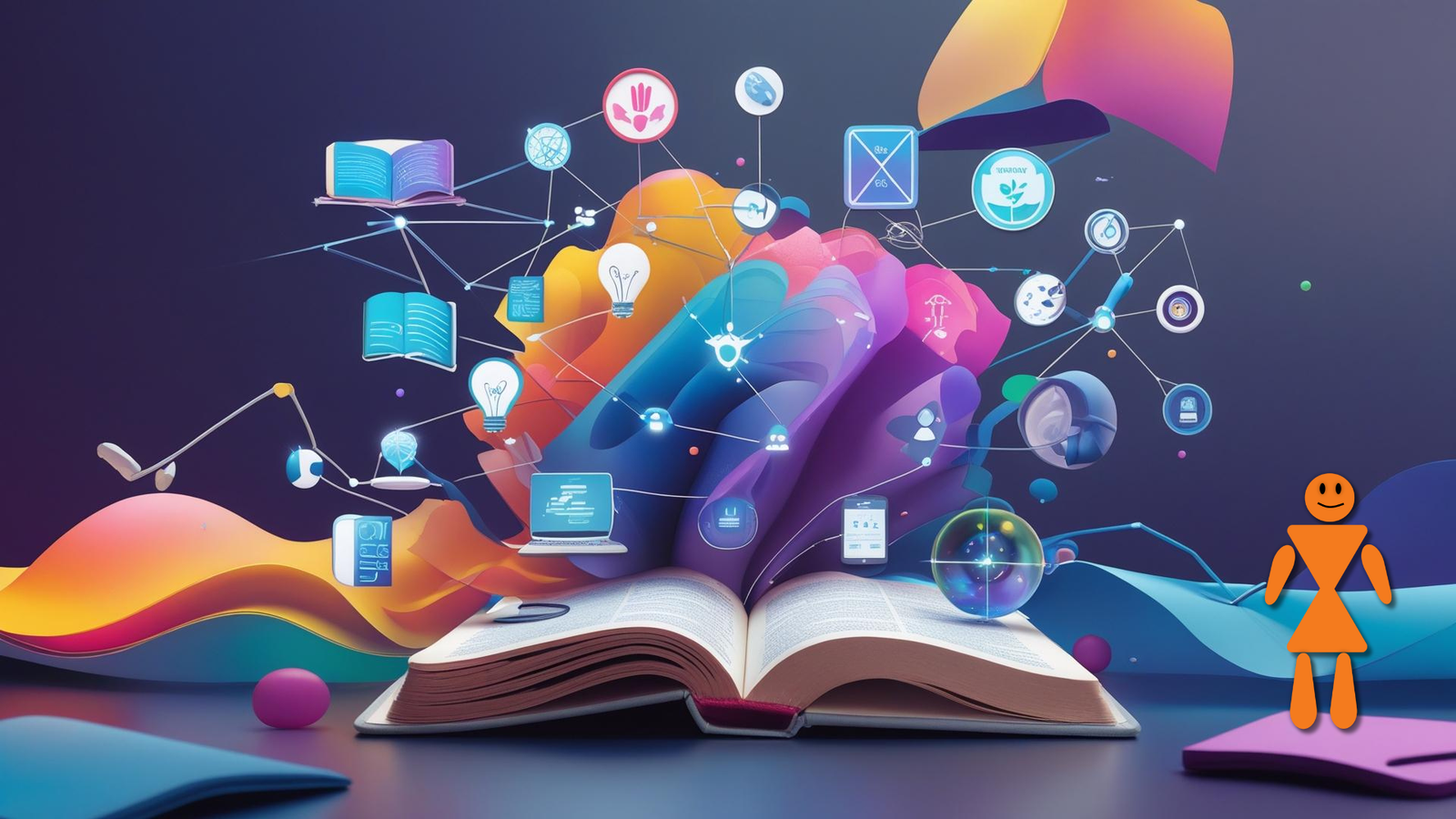
Laisser un commentaire