C’était une fin de journée tranquille.
Nous marchions en famille — mon mari, nos deux enfants et moi — profitant de cette lumière douce qui précède le soir.
Les rues commençaient à se remplir de voix, de pas pressés et de rires de terrasses. L’air portait cette odeur familière de café, de plats chauds et de fin de journée qui s’installe.
En passant devant un petit restaurant, j’ai entendu une voix claire et assurée, celle d’un garçon d’une douzaine d’années :
— « Cette année, je suis premier en anglais ! L’année dernière aussi… »
Ce ton m’a immédiatement interpellée.
Pas seulement pour ce qu’il disait, mais pour la façon dont il le disait : avec une fierté évidente, comme on annonce une victoire importante.
J’ai instinctivement tourné la tête vers la terrasse d’où venait cette voix.
À la table, ils étaient plusieurs : une femme, une petite fille, un autre homme — sans doute les parents et la sœur — et, en face du garçon, un homme plus âgé, probablement un oncle ou un ami de la famille.
C’est à lui que le garçon parlait. L’homme l’a écouté avec un sourire, lui a répondu :
— « C’est très bien, tu dois être fier de toi. »
Puis, presque dans la foulée, il a ajouté — sûrement pour prolonger la conversation, pas pour le mettre mal à l’aise :
— « Et tu pourrais me dire une phrase en anglais ? »
Le changement a été immédiat.
L’assurance du garçon a vacillé, son visage s’est figé une fraction de seconde. Ses yeux ont cherché une réponse.
Et là… c’était la gêne.
Ce que cette scène m’a appris
Nous avons continué à marcher, mais cette image restait dans ma tête.
Parce que ce moment, si simple en apparence, en disait long sur notre façon d’évaluer la réussite scolaire.
Ce garçon était premier.
Il avait obtenu la meilleure note, le meilleur rang. Et il avait raison d’en être fier.
Mais, face à une situation concrète où il devait utiliser ce qu’il avait appris, la confiance a disparu.
Il ne s’agissait plus de réciter un vocabulaire appris pour un test ou de remplir des blancs dans un exercice… mais de parler pour de vrai, à quelqu’un.
Et c’est là que se cache une question essentielle :
Prépare-t-on vraiment les élèves à réussir dans la réalité… ou seulement à briller dans le cadre scolaire ?
Le piège du classement
Le fait d’être « premier » repose sur un système qui compare et hiérarchise.
Pendant des générations, on a appris aux enfants que le succès se mesure à la place qu’ils occupent dans un classement.
Et, en soi, ce n’est pas toujours négatif :
Cela donne un repère clair.
Cela valorise un effort fourni.
Cela peut motiver certains à se dépasser.
Mais il y a un problème.
Être premier ne garantit pas de savoir utiliser ce qu’on a appris.
Cela prouve qu’on a réussi dans un contexte précis : celui des exercices, des contrôles, des barèmes.
Et parfois, cela donne une illusion : celle de maîtriser, alors qu’en réalité on a réussi un test.
Savoir scolaire et savoir réel
Le décalage entre ce qu’un élève apprend à l’école et ce qu’il peut en faire dans la vie réelle est parfois immense.
La note traduit souvent une bonne maîtrise des règles du jeu scolaire : savoir comment répondre, comment organiser son devoir, comment optimiser ses points.
Mais utiliser un savoir dans un contexte réel, c’est autre chose.
Prenons un exemple simple :
Savoir scolaire : Connaître la formule de la vitesse en physique.
Savoir réel : Être capable de l’appliquer pour calculer le temps qu’il faut pour parcourir une distance dans une situation concrète, en tenant compte de plusieurs paramètres.
Ces deux compétences ne se recouvrent pas toujours.
Et c’est ce qui explique pourquoi certains élèves brillent en contrôle mais se sentent perdus dès qu’on change légèrement la présentation du problème.
Ce n’est pas qu’en anglais…
Ce qui s’est passé ce jour-là sur cette terrasse n’est pas spécifique aux langues.
On retrouve le même phénomène dans toutes les matières, y compris celles que j’enseigne : mathématiques, physique, chimie.
Combien d’élèves excellents dans les exercices notés se retrouvent démunis devant un problème concret qui sort légèrement du cadre du cours ?
Combien maîtrisent les formules de physique par cœur… mais peinent à les appliquer dans une situation réelle ?
Combien savent résoudre un problème de chimie en suivant la méthode vue en classe… mais se perdent dès que la présentation change ?
Ce n’est pas un manque d’intelligence ou de travail.
C’est le résultat d’un apprentissage conçu pour réussir dans l’école, pas toujours en dehors.
L’enjeu est clair :
Former des élèves capables non seulement d’obtenir une bonne note, mais aussi d’utiliser leurs savoirs pour comprendre et agir dans le monde réel.
La « note identitaire » : un piège silencieux
Il arrive que des élèves finissent par se définir entièrement par leurs notes.
Le « premier » vit avec la peur de perdre sa place.
Les autres se convainquent qu’ils « ne sont pas bons » et baissent les bras.
Dans les deux cas, on réduit l’identité d’un jeune à un chiffre, en oubliant que la curiosité, la persévérance, l’esprit critique ou l’adaptabilité sont tout aussi essentiels.
Encourager autrement la fierté
Il ne s’agit pas de supprimer les notes, mais de les replacer à leur juste place.
Pour cela, on peut :
Valoriser la progression plutôt que la seule performance.
Mettre en avant l’usage concret des connaissances.
Souligner les efforts visibles, pas seulement le résultat.
Encourager la curiosité pour apprendre au-delà des tests.
Conclusion – Être premier… vraiment
La scène du restaurant m’a rappelé que la vraie réussite ne se mesure pas seulement à une place sur un classement.
Elle se mesure à la capacité d’utiliser ses connaissances, de les transformer en outils concrets, utiles et durables.
Ce garçon avait toutes les raisons d’être fier de lui.
Mais ce que j’aurais voulu lui dire, c’est :
« Garde cette fierté, mais souviens-toi que le plus important, c’est ce que tu pourras faire avec ce que tu as appris. »
Parce qu’être premier dans une classe, c’est bien.
Mais être premier dans sa vie… c’est encore mieux.
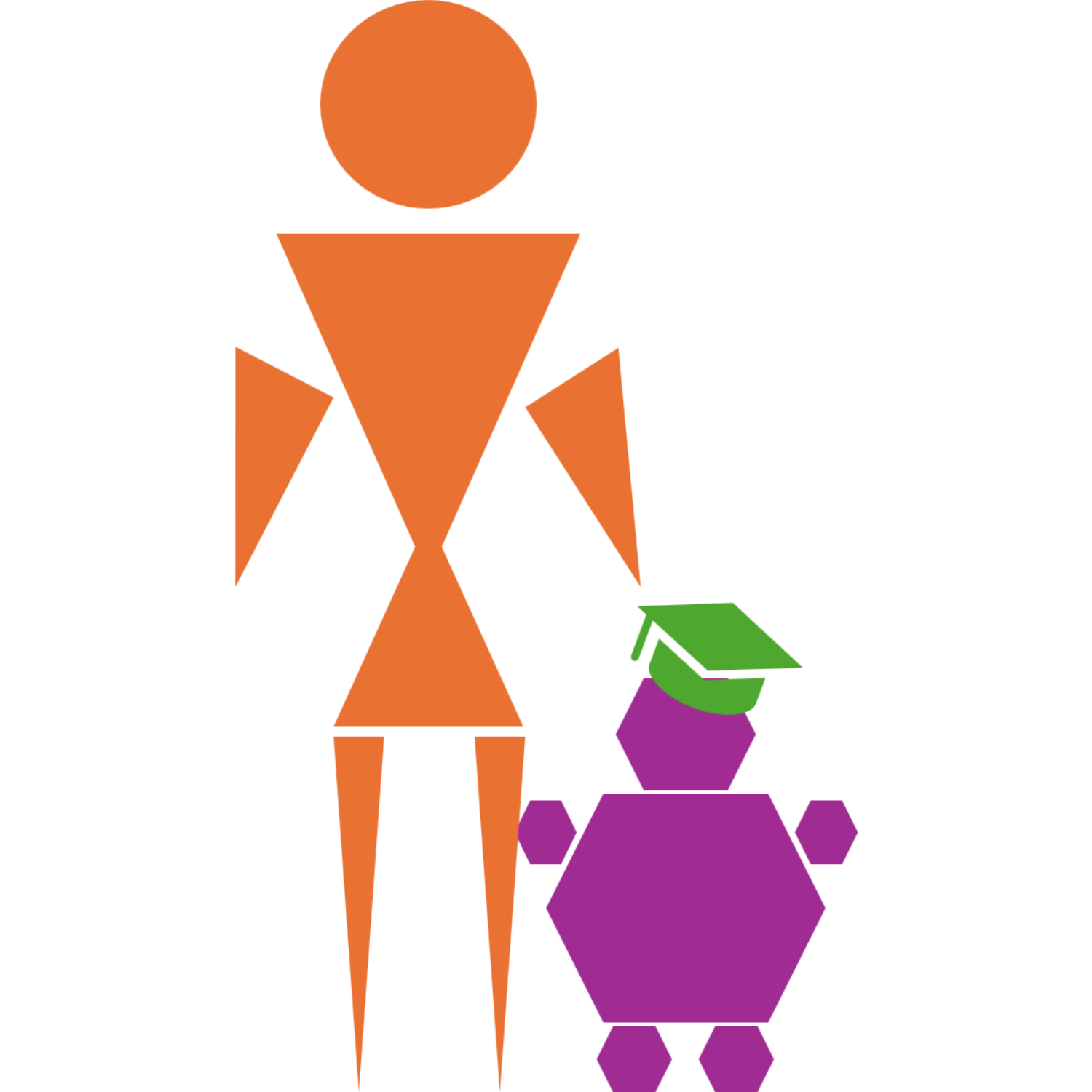


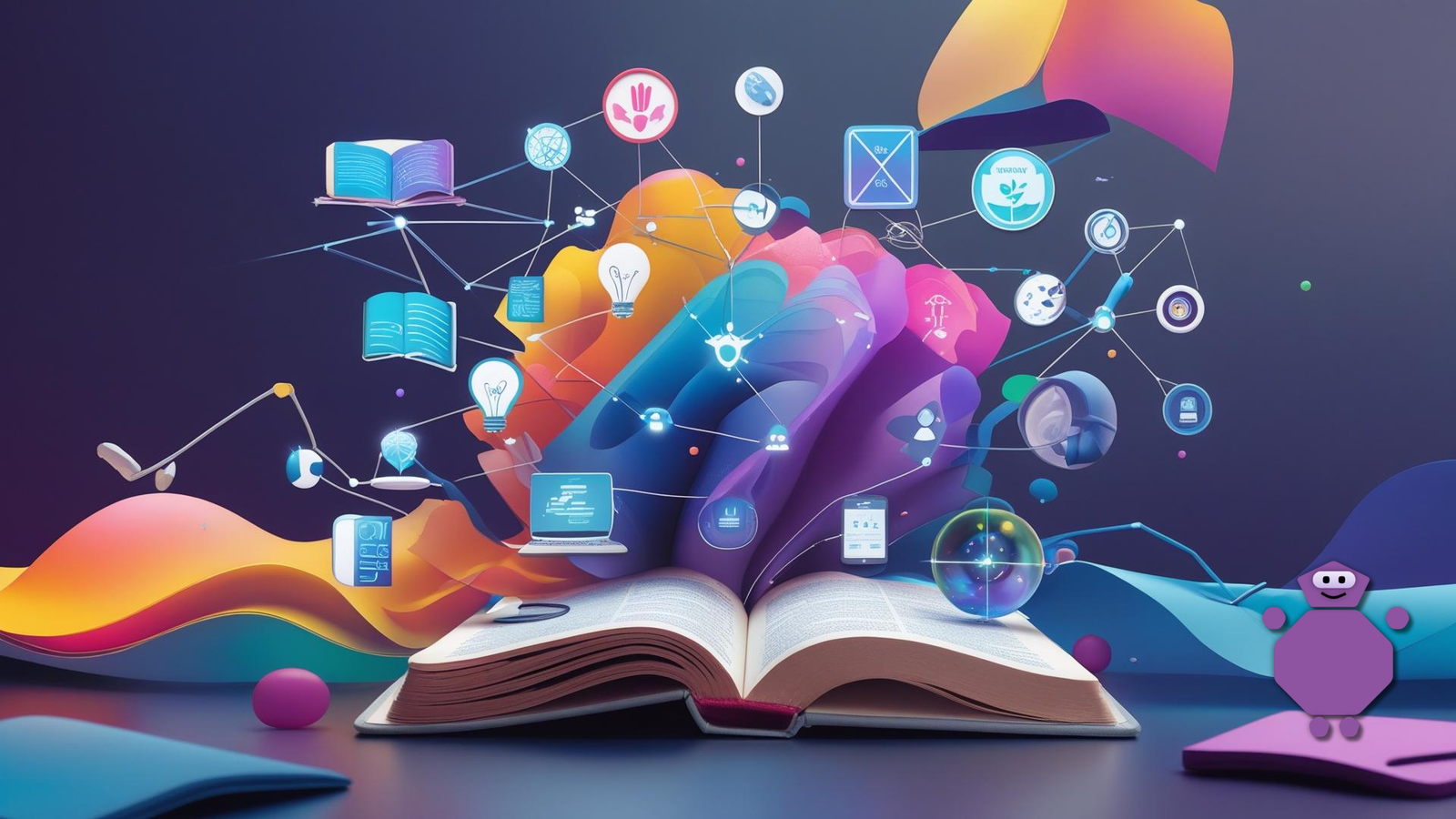
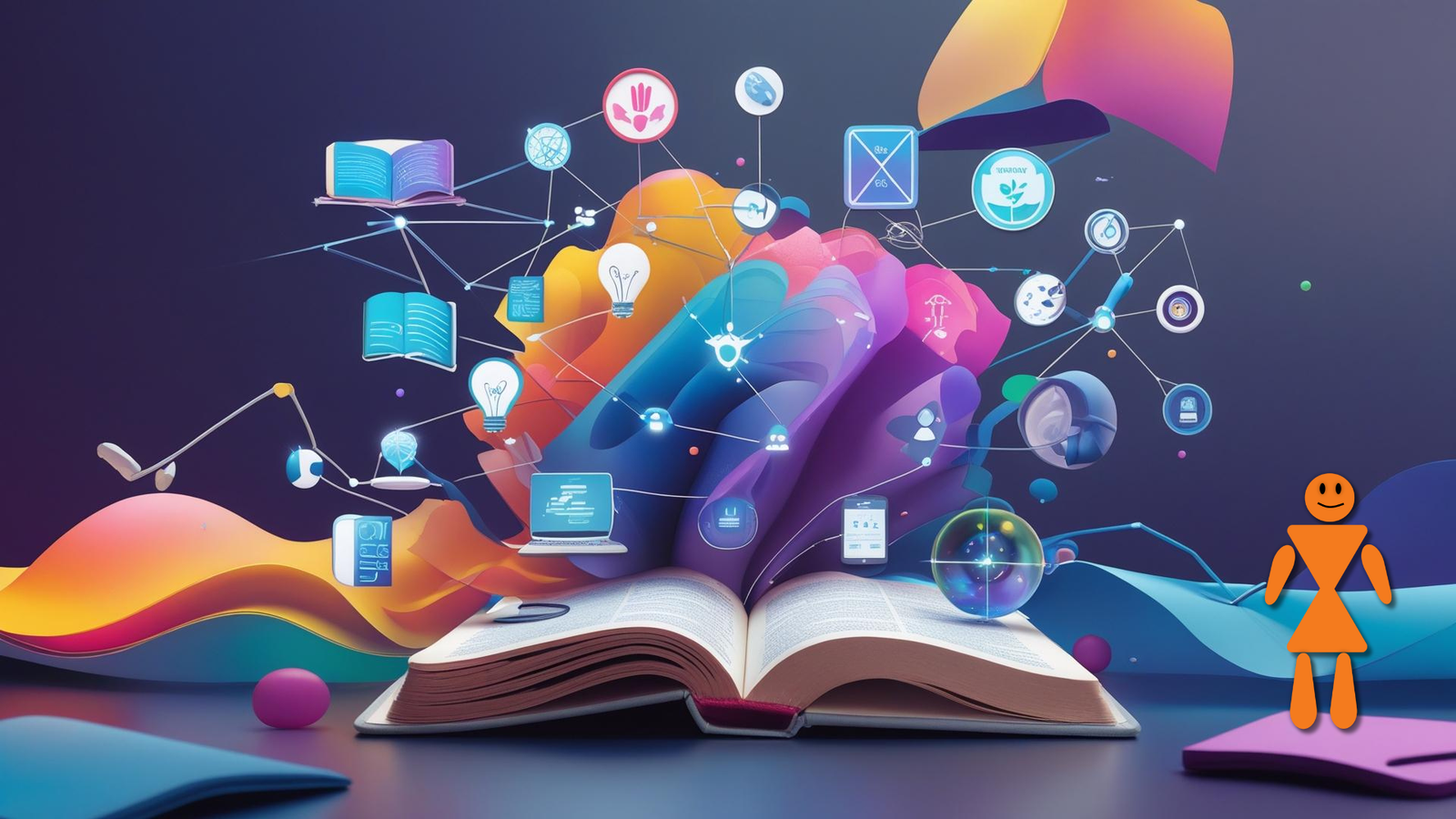
Laisser un commentaire